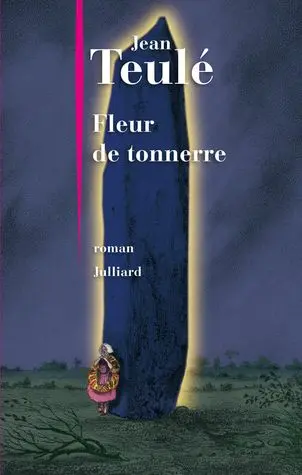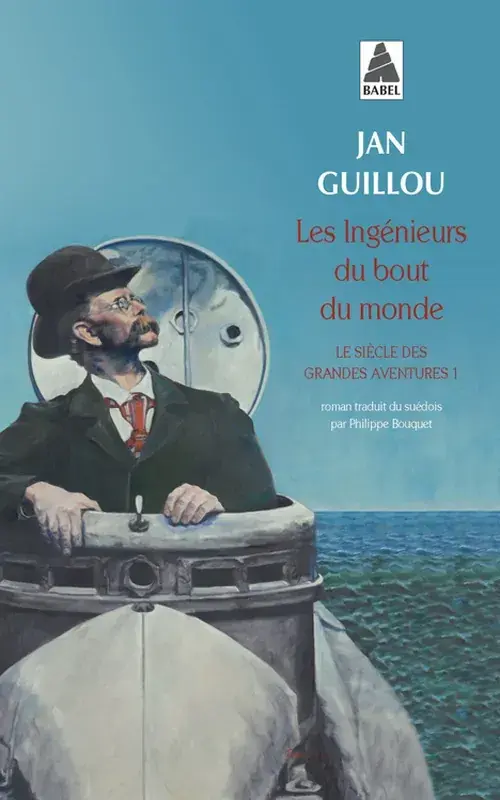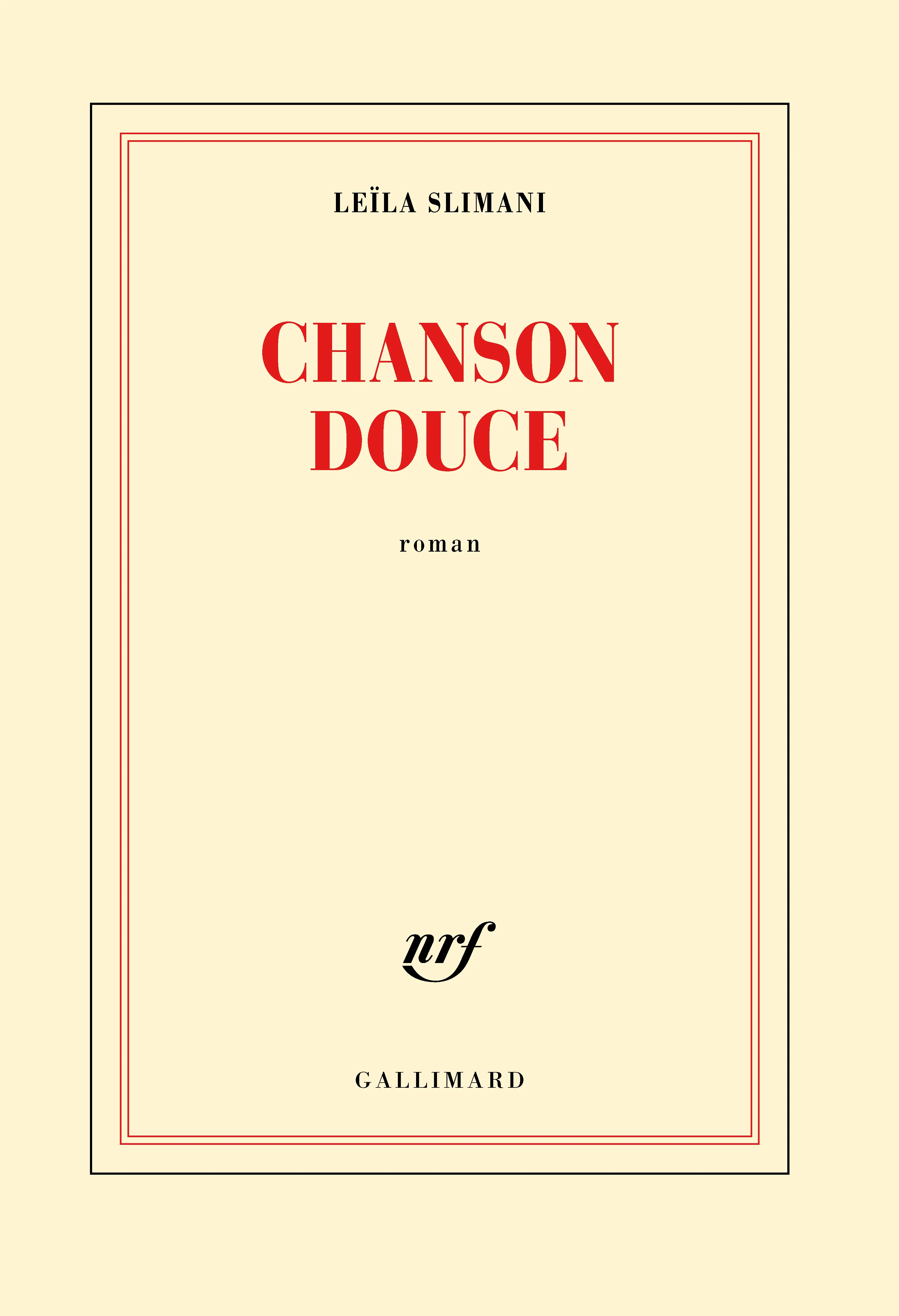
Chanson douce
Très justement récompensé, le deuxième roman de Leïla Slimani n’est pas un thriller ; d’ailleurs le suspense n’est pas là où on l’attend. Beaucoup plus dérangeant qu’éprouvant, il exerce sur le lecteur une tension insidieuse et provoque davantage de malaise que d’excitation.
Extrêmement habile et incisif dans son évocation des relations sociales entre la néo-bourgeoisie et le prolétariat, il décrit avec subtilité les rapports de force et de domination, ménage peu mais n’exagère rien pour autant. Une proximité à la fois séduisante et cruelle, envoûtante. Déstabilisante aussi.
Dès les premières pages, Louise, la nourrice des deux enfants d’un couple parisien de classe moyenne-supérieure est la coupable désignée et impardonnable d’un acte monstrueux : elle vient de tuer Mila et Adam, les jeunes enfants dont elle a la garde depuis plusieurs mois.
Que s’est-il passé dans la tête de Louise pour commettre l’irréparable ?
Emmené par une écriture vive, des phrases assez sèches et un rythme rapide, le récit remonte aux prémices du drame, et au-delà de l’émotion qu’un tel acte de folie peut engendrer, s’évertue à relater la vie somme toute ordinaire et assez banale des protagonistes et la lente (et inévitable ?) dégradation des relations sociales entre deux milieux que tout ou presque sépare.
De cette impossibilité de se comprendre, de cette rupture profonde en matière d’éducation, de culture, d’amour, de cette relation de domination et d’argent incontournables, naît alors assez distinctement l’annonce de la tragédie.
“Elle a le regard d’une femme qui peut tout entendre et tout pardonner. Son visage est comme une mer paisible, dont personne ne pourrait soupçonner les abysses.”
D’une femme en apparence “idéale” pour la fonction (“la source infaillible de leur bonheur familial”), à la fois maternelle, attentionnée, expérimentée, efficace et rassurante, se dégagent, par petites touches de plus en plus inquiétantes, une folie menaçante, des blessures ardentes impossibles à panser. Un cri de désespoir incommensurable.
“La vie est devenue une succession de tâches, d’engagements à remplir, de rendez-vous à ne pas manquer. Myriam et Paul sont débordés. Ils aiment à le répéter comme si cet épuisement était le signe avant-coureur de la réussite.”
Le lecteur pénètre avec intensité dans la vie de Myriam et Paul, couple parisien actif et dynamique, soucieux de trouver l’équilibre entre une vie professionnelle épanouie, une vie familiale apaisée et une liberté individuelle et perçoit avec justesse l’insatisfaction, la culpabilité, la frustration de ces deux personnages de ne pas toujours pouvoir être en accord avec la vie qu’ils mènent.
Avec beaucoup de finesse et finalement beaucoup de crédibilité aussi, l’auteure s’empare, de l’autre côté, et confronte à cette vie financièrement confortable, celle de Louise, précaire et sordide, où le silence est violence, où l’amour est brutal, soumis, où l’humiliation légitime une existence entière et attise le sentiment de révolte et de haine.
“Que pouvaient-ils se dire ? Qu’auraient-ils à se raconter ? […] Ils font la conversation.”
Très juste à dépeindre l’impossible spontanéité des relations entre le couple et la nourrice, Leïla Slimani, observatrice hors-pair, laisse s’immiscer, de manière progressive, un malaise de plus en plus envahissant et place le lecteur en réelle instabilité de jugement.
Car s’il connaît d’emblée la fin de l’histoire, il lit pourtant de manière continue et effrénée, happé par la réalité d’une société qu’il pensait bien connaître et qu’il veut désormais comprendre. Même s’il en résulte douleur, abattement et effroi.
Cécile Pellerin - Chronique publiée le 18/11/2016