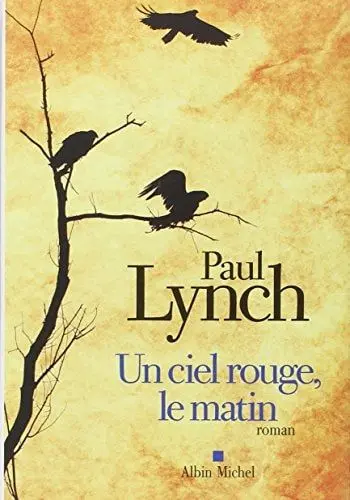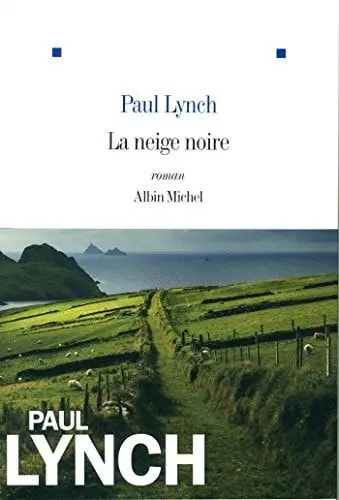
La neige noire
Certains livres offrent l'horizon, les champs de tourbe et de lande, les roches et les broussailles, les ciels tourmentés, sombres et lumineux, les paysages désolés, la mer grise, les maisons en ruine ; sans ennui ni lassitude mais avec une grande beauté.
Certains livres délivrent des odeurs, du bruit et d'autres sensations vives, l'humidité de la terre, le souffle froid de la pluie intense, la puanteur des animaux carbonisés, les sonorités du feu, l'aboiement du chien, le cri des vaches, le bourdonnement des abeilles, le jugement de Dieu, les médisances de voisinage, la rumeur de la guerre au loin, le silence absolu ; une précision ciselée du réel, percutante, parfois brutale et déchirante, à ressentir aussitôt.
Certains livres, âpres et douloureux, intensément tragiques et pénétrants, d'une tonalité lyrique admirable, éprouvent autant qu'ils réjouissent, caressent autant qu'ils assènent. Neige noire est de tous ceux-là, et comme Un ciel rouge, le matin, Le 1er roman de Paul Lynch, il s'introduit chez le lecteur par tous les sens, ineffable et sublime. Un livre hors du temps, absolument incontournable.
Barnabas Kane est revenu dans le Donegal après avoir émigré aux Etats-Unis. Avec Eskra, sa femme d'origine irlandaise mais née à Brooklyn et leur fils Billy, 14 ans, ils exploitent une petite ferme au cœur d'une nature parfois hostile, encore sauvage. Un incendie accidentel ou criminel ravage l'étable de l'exploitation agricole, tue un vieil ouvrier, Matthew Peoples et plonge chaque membre de la famille, tour à tour, dans une tragédie profonde dont on pressent que nul n'en ressortira indemne.
"Les portes noires de l'Enfer venaient brusquement de s'ouvrir".
L'épreuve, telle un châtiment biblique, les isole de la communauté villageoise, fait naître le sentiment de culpabilité, les tourments puis l'abattement, la douleur immense, le désœuvrement et la souffrance invalidante, les regrets, l'insécurité, l'exclusion et le bannissement, la folie ; interroge aussi Barnabas et Eskra sur ce choix de nouveau départ dans un pays où ils ne sont plus les bienvenus.
"Un homme peut-il endiguer la marée par sa seule force, repousser l'implacable océan sans étoiles qui monte pour tout détruire ? Lorsque la lame s'abat sur lui, elle l'engloutit entièrement […] Je me suis tué à la tâche, c'est la vérité. Des gens comme moi qui se consacrent à ce pays […]
Peut-être que ces connards ont raison, quand ils disent que je suis un faux-pays […] Je suis originaire de ce pays, mais je n'en fait pas partie."
Magnifiée par une tonalité poétique très personnelle et puissamment évocatrice, l'histoire si musicale, qu'on a envie de la lire à haute voix, fluide et sans rupture (les dialogues sont notamment introduits sans marques typographiques) accapare le lecteur tout entier. Son corps est parcouru de frissons, redoute les violences d'un climat devenu soudain moins clément, perçoit la pluie et le vent qui s'annoncent à mesure que Barnabas sombre dans le désespoir, éprouve l'odeur de suie prégnante sur les draps mis à sécher. Mais il est aussi capable, lorsque, de manière fugace, de doux instants de vie rejaillissent, de s'en saisir également et d'accompagner Eskra, Billy ou Barnabas avec la même proximité ; sensible au soleil qui pointe, aux fleurs qui s'épanouissent, au grand rire de Barnabas, "à la vitalité des sèves de printemps, cette puissance démesurée qui relève les arbres et couvre de verdure la terre frémissante."
Ainsi, la précision des descriptions, leur découpage quasi-cinématographique par moments, concèdent au roman une tonalité très visuelle et expressive, élégamment rythmée, dont le lecteur s'imprègne naturellement, conquis et bouleversé.
Convaincu, à travers la traduction remarquable de Marina Boraso, que Paul Lynch, au-delà des modes et des courants littéraires est déjà un auteur classique. Un grand.
Cécile Pellerin - Chronique publiée le 16/10/2015